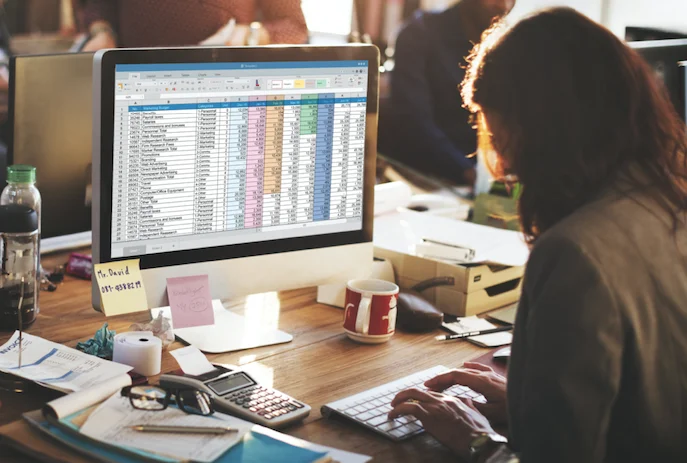Assurer la gestion financière d’un CSE, ce n’est pas qu’une affaire de bons comptes. C’est aussi une question de transparence, de responsabilité… et de loi. La comptabilité CSE répond à des règles bien précises, qui varient selon la taille du comité. Petit, moyen ou grand CSE : chacun a ses obligations.
Vous vous demandez quels documents produire ? Quand faire appel à un expert-comptable ? Ou encore comment séparer vos budgets AEP et ASC ? Ce guide vous éclaire point par point, avec des conseils pratiques pour faciliter votre quotidien d’élu.
Pourquoi le CSE est-il soumis à des obligations comptables ?
Un comité social et économique (CSE), ce n’est pas seulement un relais entre les salariés et la direction. C’est aussi une structure dotée d’un budget, de responsabilités… et donc, de comptes à rendre. En tant que personne morale, le CSE est tenu de respecter un cadre comptable strict, au même titre qu’une association ou une petite entreprise.
Le CSE, une entité autonome avec des responsabilités
Dès sa création, le CSE possède une personnalité juridique propre. Cela signifie qu’il peut signer des contrats, dépenser, recevoir des subventions… mais aussi qu’il doit justifier de la bonne utilisation de ses fonds. Que ce soit pour les activités sociales et culturelles (ASC) ou le fonctionnement courant (AEP), toutes les dépenses doivent être tracées et justifiées.
Cette logique s’inscrit dans une volonté de transparence vis-à-vis des salariés, qui sont les premiers bénéficiaires des actions menées. En tant qu’élu, vous êtes responsable devant eux et devant la loi.
Des obligations encadrées par la loi
La base juridique de la comptabilité CSE repose sur plusieurs textes essentiels :
- La loi du 5 mars 2014, qui a renforcé les exigences de transparence financière pour les comités d’entreprise (transposées ensuite aux CSE)
- L’ordonnance du 22 septembre 2017, qui a fusionné CE, CHSCT et DP pour donner naissance au CSE unique
- Et l’article L.123-12 du Code de commerce, qui impose une comptabilité adaptée à la taille de chaque structure
Ces textes précisent notamment quels documents produire, quand faire appel à un expert, et à quels seuils les règles changent.
Un outil de gestion, pas une contrainte
Tenir une comptabilité, ce n’est pas simplement “cocher une case”. C’est un levier de pilotage pour mieux maîtriser les dépenses, anticiper les besoins et sécuriser les actions du comité. Et quand on est bien outillé, cela devient vite une routine… plutôt qu’un casse-tête.
Besoin de clarifier certains termes juridiques ou comptables ?
Consultez notre lexique complet du CSE pour mieux comprendre les notions clés.
Quelles sont les obligations comptables selon la taille du CSE ?
Toutes les structures CSE ne sont pas logées à la même enseigne. La loi distingue trois catégories de comités : petits, moyens et grands, en fonction de leurs ressources financières et de leur taille. À chaque niveau correspond un degré d’exigence comptable spécifique. Objectif : adapter les obligations à la capacité de gestion réelle du comité.
Comptabilité ultra-simplifiée : pour les petits CSE (≤ 153 000 € de ressources)
Les CSE considérés comme « petits » sont ceux dont les ressources annuelles (AEP + ASC cumulés) ne dépassent pas 153 000 €. Ils bénéficient d’un cadre très allégé :
- Une comptabilité de trésorerie à partie simple
- Un livre retraçant chronologiquement les recettes et les dépenses
- Un état de synthèse annuel, présentant le patrimoine et les engagements en cours
Aucun bilan comptable formel, ni recours obligatoire à un expert-comptable. Ce fonctionnement reste néanmoins encadré et doit pouvoir être justifié à tout moment en cas de contrôle.
Comptabilité simplifiée : pour les CSE de taille moyenne
Ces comités dépassent le seuil de 153 000 €, sans franchir plus de deux des trois limites suivantes :
- Moins de 50 salariés dans l’entreprise
- Moins de 1,55 million d’euros de total bilan
- Moins de 3,1 millions d’euros de ressources
Ils doivent tenir une comptabilité à partie double, mais peuvent simplifier certaines modalités, notamment en n’enregistrant les créances et dettes qu’à la clôture de l’exercice.
→ L’expert-comptable est ici obligatoire pour la présentation des comptes. Le coût est à prendre sur le budget de fonctionnement (AEP).
Comptabilité complète : pour les grands CSE
Lorsque le CSE dépasse au moins deux des trois seuils ci-dessus, il passe en catégorie “grande taille”. Dans ce cas, les exigences sont les plus strictes :
- Comptabilité d’engagement complète (enregistrements au fil de l’eau)
- Présentation annuelle des comptes par un expert-comptable
- Nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC) et de son suppléant
- Production d’un rapport de gestion détaillé et d’un rapport sur les conventions
Le comité peut aussi être amené à mettre en place une commission des marchés, pour encadrer les achats et prestations.
Récapitulatif des obligations par type de CSE
Type de CSE | Seuils & critères | Obligations principales | |
Petit CSE | ≤ 153 000 € de ressources | Comptabilité simple, livre de comptes, état de synthèse | |
CSE moyen | > 153 000 € + max 2 seuils franchis | Comptabilité à partie double, expert-comptable obligatoire | |
Grand CSE |
| Comptabilité complète, expert-comptable + CAC, rapports obligatoires |
Ouvrez votre compte CSE en seulement 48h
Quels documents le CSE doit-il produire et conserver ?
Tenir une comptabilité claire ne suffit pas : encore faut-il tous savoir quels documents produire, quand, et combien de temps les conserver. Ces obligations varient selon la taille du CSE, mais certaines pièces sont incontournables, quel que soit le comité.
Les documents comptables obligatoires
Selon le code du Commerce (article L.123-12) et les textes spécifiquement aux CSE, plusieurs documents doivent être établis chaque année :
Le compte de résultat : il permet de savoir si le CSE a réalisé un excédent ou un déficit.
- Le bilan comptable : il dresse un état du patrimoine du comité (actif et passif).
- L’annexe : elle apporte des précisions sur les comptes et les méthodes utilisées.
- L’état de synthèse (pour les petits CSE uniquement)
- Le rapport de gestion : obligatoire pour les CSE moyens et grands, il donne une vision globale de l’activité.
- Le rapport sur les conventions : s’il y a eu des transactions entre le CSE et un ou plusieurs de ses membres (article L.2315-70 du Code du travail)
Ces documents doivent être présentés en réunion CSE, notamment dans le cadre de l’approbation des comptes.
Durée légale de conservation
La loi impose des durées minimales de conservation, principalement pour se prémunir en cas de contrôle ou de litige :
- 10 ans pour les livres comptables, factures, relevés bancaires, bilans, comptes de résultat
- 6 ans pour les procès-verbaux de réunion
- 5 à 30 ans selon la nature des contrats (ex. : baux, conventions, prestations)
Ne pas respecter ces délais peut engager la responsabilité du trésorier en cas de problème ou de contrôle URSSAF
Qui supervise et valide les comptes du CSE ?
La comptabilité du CSE ne s’arrête pas à simple tenue des comptes. Selon la taille du comité, elle doit être présentée, validée, voire certifiée par des professionnels extérieurs. Ces étapes sont essentielles pour garantir la transparence et la conformité de la gestion.
L’expert-comptable : un partenaire obligatoire dès 153 000 €
Dès que les ressources du CSE dépassent 153 000 €, un expert-comptable doit être mandaté pour présenter les comptes annuels. Cette obligation concerne les CSE de taille moyenne et grande. L’expert vérifie les documents, rédige un rapport, et assiste le comité dans l’interprétation des résultats financiers.
→ Ce coût est financé via le budget AEP, et non sur les ASC.
Le commissaire aux comptes : une exigence pour les grands CSE
Lorsque le CSE dépasse au moins deux des trois seuils réglementaires (50 salariés,
1,55 M€ de bilan, 3,1 M€ de ressources), il doit désigner un commissaire aux comptes (CAC), ainsi qu’un suppléant.
Leur rôle :
- Certifier les comptes du comité (non seulement les lire, mais les valider légalement)
- Exercer un pouvoir d’alerte, en cas d’anomalie
- Vérifier la conformité des conventions conclues
Cette mission vise à sécuriser les finances du CSE… mais aussi à rassurer les salariés bénéficiaires.
Comment fonctionnent les budgets AEP et ASC ?
Le CSE dispose de deux budgets distincts, versés par l’employeur :
l’un pour ses activités internes, l’autre pour les avantages destinés aux salariés. Bien les distinguer est indispensable pour rester dans les clous… et éviter tout risque de requalification ou de sanction.
Le budget AEP : pour le fonctionnement du CSE
Le budget de fonctionnement, aussi appelé AEP (Activités Économiques et Professionnelles), permet de couvrir toutes les dépenses liées à l’exercice des missions du comité :
- Achat de fournitures, matériel informatique
- Formations des élus
- Recours à un expert-comptable ou à un avocat
- Frais liés aux réunions (déplacements, documentation…)
→ Il est obligatoire dès 50 salariés et représente 0,20 % de la masse salariale brute (ou 0,22 % dans les entreprises de plus de 2 000 salariés).
Le budget ASC : pour les prestations aux salariés
Le budget ASC (Activités Sociales et Culturelles) sert à financer tout ce qui touche au bien-être et au pouvoir d’achat des salariés :
- Billetterie, chèques-cadeaux
- Aide aux vacances ou aux activités sportives
- Noël des enfants, arbres de fin d’année…
→ Ce budget est facultatif, mais souvent versé par l’employeur selon usage ou accord.
Peut-on transférer une partie de l’AEP vers l’ASC ?
Oui. Depuis l’ordonnance de 2017, jusqu’à 10 % du budget AEP peut être transféré vers l’ASC en fin d’année, à condition qu’il y ait un excédent et qu’une délibération du CSE le valide. L’inverse n’est pas autorisé.
Qui est responsable de la comptabilité dans un CSE ?
La tenue des comptes du CSE n’est pas une tâche collective : elle repose principalement sur une personne-clé du comité. Il s’agit du trésorier, élu lors de la première réunion plénière du CSE.
Le trésorier : garant des finances du comité
Le trésorier est responsable de la gestion comptable et financière du CSE. À ce titre, il :
- suit les mouvements sur les comptes AEP et ASC,
- prépare les budgets prévisionnels,
- veille à la bonne affectation des dépenses,
s’assure du respect des obligations comptables.
Il collabore avec l’expert-comptable si le CSE y est soumis, et présente les comptes en réunion plénière pour approbation.
Une fonction encadrée par la loi
Le rôle du trésorier n’est pas seulement technique : il engage sa responsabilité personnelle, notamment en cas de gestion frauduleuse ou de non-respect des règles (abus de confiance, mauvaise affectation des budgets, etc.).
C’est pourquoi il est essentiel que le trésorier soit bien formé, entouré et outillé d’une solution de suivi clair et sécurisé.
Faut-il ouvrir deux comptes bancaires pour le CSE ?
Ce que dit la loi
Aucun texte n’impose formellement au CSE d’ouvrir deux comptes séparés. En revanche, la distinction entre le budget de fonctionnement (AEP) et celui des activités sociales et culturelles (ASC) est obligatoire.
Dans les faits, la plupart des CSE choisissent d’avoir deux comptes distincts pour éviter les erreurs, simplifier les suivis et gagner en lisibilité.
Une bonne pratique… facilitée par CSE Finance
Séparer les budgets AEP et ASC, c’est essentiel pour respecter les règles, mais aussi pour simplifier la gestion au quotidien. Pour cela, il est utile de s’appuyer sur une solution bancaire pensée pour les CSE.
CSE Finance propose une offre bancaire adaptée aux CSE, avec tous les outils nécessaires pour une gestion rigoureuse et accessible :
- Deux comptes séparés pour bien distinguer fonctionnement (AEP) et activités sociales (ASC)
- Un suivi en temps réel grâce à une interface claire, accessible 24h/24
- Des cartes Mastercard dédiées à chaque budget ou utilisateur, selon les besoins de votre comité
Vos obligations comptables en un coup d’œil
- Tenez une comptabilité adaptée à la taille de votre CSE
- Présentez vos comptes en réunion plénière
- Faites appel à un expert-comptable ou un CAC si nécessaire
- Conservez tous les documents pendant au moins 10 ans
- Séparez clairement les dépenses AEP et ASC
Les obligations comptables du CSE en résumé
Quelles sont les obligations comptables du CSE ?
Chaque CSE, quelle que soit sa taille, doit tenir une comptabilité. Cela inclut au minimum un suivi des recettes et des dépenses, et selon les cas, l’élaboration d’un compte de résultat, d’un bilan, d’une annexe et d’un rapport de gestion. Les obligations varient en fonction du niveau de ressources et des effectifs de l’entreprise. Plus le CSE est grand, plus les exigences sont poussées.
Quelle est la différence entre le budget AEP et le budget ASC ?
Le budget AEP (Activités Économiques et Professionnelles) finance le fonctionnement du CSE : formations, expert-comptable, matériel…
Le budget ASC (Activités Sociales et Culturelles) est consacré aux avantages proposés aux salariés : billetterie, vacances, chèques-cadeaux. Ces deux budgets doivent être gérés séparément, avec des justificatifs propres à chacun.
Quand un CSE doit-il nommer un commissaire aux comptes ?
La nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) devient obligatoire dès lors que le CSE dépasse au moins deux des trois seuils suivants :
- 50 salariés,
- 1,55 million d’euros de total bilan,
- 3,1 millions d’euros de ressources annuelles.
Le CAC certifie les comptes et dispose d’un droit d’alerte.
Un expert-comptable est-il obligatoire pour un CSE ?
Oui, dès que le CSE dépasse 153 000 € de ressources annuelles, un expert-comptable doit être sollicité pour présenter les comptes. Il accompagne le comité dans la lecture des documents financiers et garantit leur conformité. Cette prestation est financée par le budget de fonctionnement (AEP).
Quelle comptabilité un petit CSE doit-il tenir ?
Un CSE dont les ressources annuelles ne dépassent pas 153 000 € tient une comptabilité ultra-simplifiée. Cela implique :
- un livre retraçant les recettes et dépenses,
- un état de synthèse annuel,
- et aucun recours obligatoire à un expert-comptable.
Cette comptabilité reste néanmoins encadrée par la loi et doit pouvoir être justifiée en cas de contrôle.